Il a des mains de la taille d’une brique, des épaules larges et épaisses. « Un homme de ma carrure et une femme comme elle… J’aurais pu lui déboîter la mâchoire. » Ce jour là, « il y a un an environ », Jean (tous les prénoms des auteurs ont été modifiés) se rappelle avoir suspendu son poing en l’air, pour en dévier la trajectoire et venir frapper l’arrière du crâne de sa femme. « Pas le visage. Je me suis juste dit pas le visage. » Sa compagne hurle, « elle s’est mise à saigner du nez, la force du choc j’imagine. » Le quadragénaire lâche sa victime, qui appelle aussitôt les gendarmes. Il quitte le domicile avec les forces de l’ordre, calme et sans protester, sous les yeux de ses deux enfants.
Un stage pour répondre à « l’obligation de soin »
Si aujourd’hui Jean parle, c’est parce qu’il a réussi à mettre des mots sur ses actes. Et qu’il reconnaît « avoir commis l’impardonnable ». Une évolution du discours, qui a pu se faire grâce au long travail de mise en confiance réalisé par l’équipe de l’Arsea (Association régionale spécialisée d’action sociale d’éducation et d’animation). Depuis 2015, cette importante association d’aide sociale accompagne les auteurs de violences conjugales, par le biais d’entretiens individuels psychologiques.
Début 2020, l’Arsea met en place des stages dits « de responsabilisation », en partenariat avec les tribunaux de Strasbourg et de Saverne. Ces stages répondent aux obligations de soins, prononcées lors de condamnations pour des faits de violences conjugales.

« Lorsque j’ai vu le procureur qui m’a parlé de mon cas, il m’a dit : c’est soit un jugement au tribunal, avec la possibilité que ce soit 3 ans de prison ferme et 30 000€ d’amende, soit un stage de responsabilisation à 240€ ». Le regard bleu perçant de Jean se fait un brin ironique derrière le masque : « Il n’y avait pas besoin de réfléchir 2 ans. » Et puis le père de famille l’avoue sans honte, « je pensais que ça ne servirait à rien, que c’était une connerie, comme les stages pour récupérer les points de permis. »
Alors, il y va, deux heures par semaine, pendant 6 semaines. Ce salarié du bâtiment se prête au jeu du stage. Entretien psychologique individuel d’abord. Puis, le fameux groupe de parole, où il rencontre 11 auteurs de violences conjugales, comme lui. « Au début on se regarde tous et on se demande comment les uns et les autres se sont retrouvés là. Il y a de la gêne. Et puis, avec les questions – pardon – mais les questions à 10 balles de la psychologue, tout à coup, on se livre, on raconte toute sa vie, et là on comprend. »

17 ans de violences, « mais je ne savais pas que c’étaient des violences »
Comprendre déjà, qu’ils ne sont pas seuls. « Et y en a de tous les milieux hein ! », précise Gilbert, un autre homme suivi par l’Arsea depuis septembre. Avocat, ancien gendarme, pâtissier, retraité, étudiant… « Toutes classes sociales, de tous les milieux culturels et de tous les âges aussi », précise Isabel Zapata, psychologue de la structure. Leur point commun ? « Ils ont tous beaucoup de mal à reconnaître les faits. Pour eux, ils ne sont pas coupables mais plutôt victimes. »
Dans les mots de Jean ou de Gilbert : « elle m’a cherché », « elle m’a poussé », « elle savait que j’allais péter un plomb », « elle a essayé de me taper avec un manche à balais… » Il y a aussi une minimisation des faits. Jean raconte ainsi qu’il avait déjà eu, à plusieurs reprises, « des gestes », mais « pas grand chose », précise-t-il. « C’était juste des plaquages contre le mur, ou bien je la serrais dans mes bras pour lui bloquer les mains, mais c’était pour la calmer », explique-t-il.
Puis l’homme de 49 ans raconte comment, depuis le début de son histoire amoureuse, la violence est entrée, insidieusement, comme une tierce personne dans le couple. « On ne se rend pas compte. On se dit, dans les couples, il y a toujours des prises de tête, cette fois-ci on en est venus aux mains, mais c’est normal. En fait ce n’était pas normal et c’étaient des violences. » Ses yeux s’embuent de quelques larmes discrètes lorsque Jean se met à parler de ses enfants. Pour eux aussi, « il peut y avoir des conséquences plus tard, de ces violences. C’est ce que j’ai appris avec le stage ».
« S’occuper des auteurs, c’est aussi protéger les victimes »
Une association pour les auteurs et non pour les victimes de violences, le concept peut surprendre. Claire Rossini, responsable du projet, détaille :
« Pour les victimes, le réseau bas-rhinois est très dense. Il y a énormément d’associations de soutien, d’hébergement, d’aide juridique et c’est bien normal. Mais pour les auteurs, il n’y avait personne. C’est ce qui a motivé l’Arsea. On ne peut pas laisser des auteurs de violence sans rien. Quand il y a passage à l’acte, il faut comprendre d’où ça vient, essayer de “soigner”. S’occuper des auteurs, c’est aussi protéger les victimes ».
Claire Rossini, chef du service d’accompagnement socio-judiciaire de l’Arsea.
Le stage permet aux auteurs de prendre conscience de leur violence et de mettre en place des stratégies d’évitement, de réfléchir à des questions plus intimes sur l’origine de cette violence… « C’est un travail que l’auteur lui-même doit faire, rappelle Claire Rossini. La victime doit se protéger mais il faut prendre le problème à la base. »
Addictions, enfants, ce que disent le droit et la loi sur la violence : tous les thèmes sont abordés
Lors des 6 séances de deux heures, différentes associations prennent la parole devant les stagiaires. Il y a par exemple l’association ALT sur les addictions (souvent mises en cause dans les problèmes de violences conjugales), l’association Viaduq sur les conséquences pour les victimes, femmes et enfants, ou encore le CIDFF (Centre d’information sur les droits des femmes et des familles) qui anime un atelier sur l’égalité homme – femme.

Pour Gilbert, ces ateliers sur la définition de la violence lui ont fait prendre conscience de l’importance des mots. Le jeune homme de 33 ans qui travaille dans la restauration raconte cette après-midi du 25 décembre 2019, où il a « pété les plombs ». Une énième dispute éclate avec sa compagne, « à propos de problèmes d’ordre sexuel dans notre couple, vu qu’elle venait d’accoucher, et moi je ne voulais pas comprendre. On a commencé à s’insulter, c’est monté, c’est monté, et je l’ai plaquée au sol, avec vraiment l’envie de la frapper. Je me suis retenu et j’ai finalement mis mon poing dans la commode juste à côté, que j’ai explosée. »
Le trentenaire n’est pas fier et reconnaît le climat malsain qui régnait dans son couple depuis plusieurs années. « Des violences verbales qui sont devenues physiques ». Grâce au stage, il a compris une chose : « il faut énormément dialoguer. Moi j’encaisse, j’encaisse et au bout d’un moment, la cocotte minute, elle explose. Donc il faut dire les choses. Quand on a la pression du boulot, la pression à la maison, ça explose. »
Une action débutée en 2015, soutenue par le Grenelle depuis 2020
De 2015 à 2020, 400 personnes ont été suivies par l’Arsea, en entretiens psychologiques individuels. Depuis 2020 et la mise en place des stages, ce sont 84 auteurs de violences (dont 5 femmes) qui ont été accompagnés. « À long terme, nous visons de suivre 250 personnes par an », explique Claire Rossini. Car depuis le Grenelle des violences conjugales, l’action pionnière de l’Arsea est davantage reconnue. Et surtout, davantage financée.

« Notre projet fait partie des 16 sélectionnés. Nous avons reçu une subvention de 150 000€ ce qui a doublé notre budget de fonctionnement », s’enthousiasme Claire Rossini. Conséquence : deux embauches supplémentaires dans l’équipe (un travailleur social et un contrôleur judiciaire), et le travail de la psychologue a été transformé en un temps plein.
Autre changement prévu dans les mois à venir : un déménagement du centre. « Nous sommes voués à nous agrandir et à accueillir de plus en plus d’auteurs. Trois stages sont déjà programmés pour janvier et février 2021 et ils sont tous complets. Il nous faut des locaux plus adaptés », explique la responsable.

84 personnes suivies en 2020, environ 70% de « réussite » mais pas de chiffre sur la récidive
La grande question qui reste en suspens, c’est celle de l’efficacité de cette mesure judiciaire, notamment sur la récidive. « La seule façon de le savoir, ce serait d’avoir accès aux chiffres des condamnations pénales, aux statistiques de la justice. Pour l’instant, ces chiffres sont confidentiels, mais nous y travaillons également », assure la jeune directrice avant de reconnaître : « Il est certain qu’il faudra un outil d’évaluation objective à un moment ».

Un dispositif encore très jeune pour l’Arsea, avec ces stages nés en janvier 2020, et zéro chiffre sur la récidive du public suivi depuis 2015… Mais malgré cela, Isabel Zapata se veut optimiste :
« Je suis confiante, et – même si ce n’est qu’un ressenti, je dirais qu’environ 70% des personnes que nous avons reçues ici, sont réceptives à notre discours. »
C’est le cas de Gilbert, qui semble transformé par le stage. « Des grosses amendes ou de la prison, ça ne change rien du tout, ça ne permet pas de se remettre en question. Sur le coup, on paie, ça nous embête, mais ce n’est que de l’argent. Alors que là, on fait un stage et on comprend des choses. » Le jeune trentenaire en est sûr : « Si je n’avais pas fait le stage, j’aurais continué comme ça. Avec une autre femme peut-être, mais j’aurais continué. »

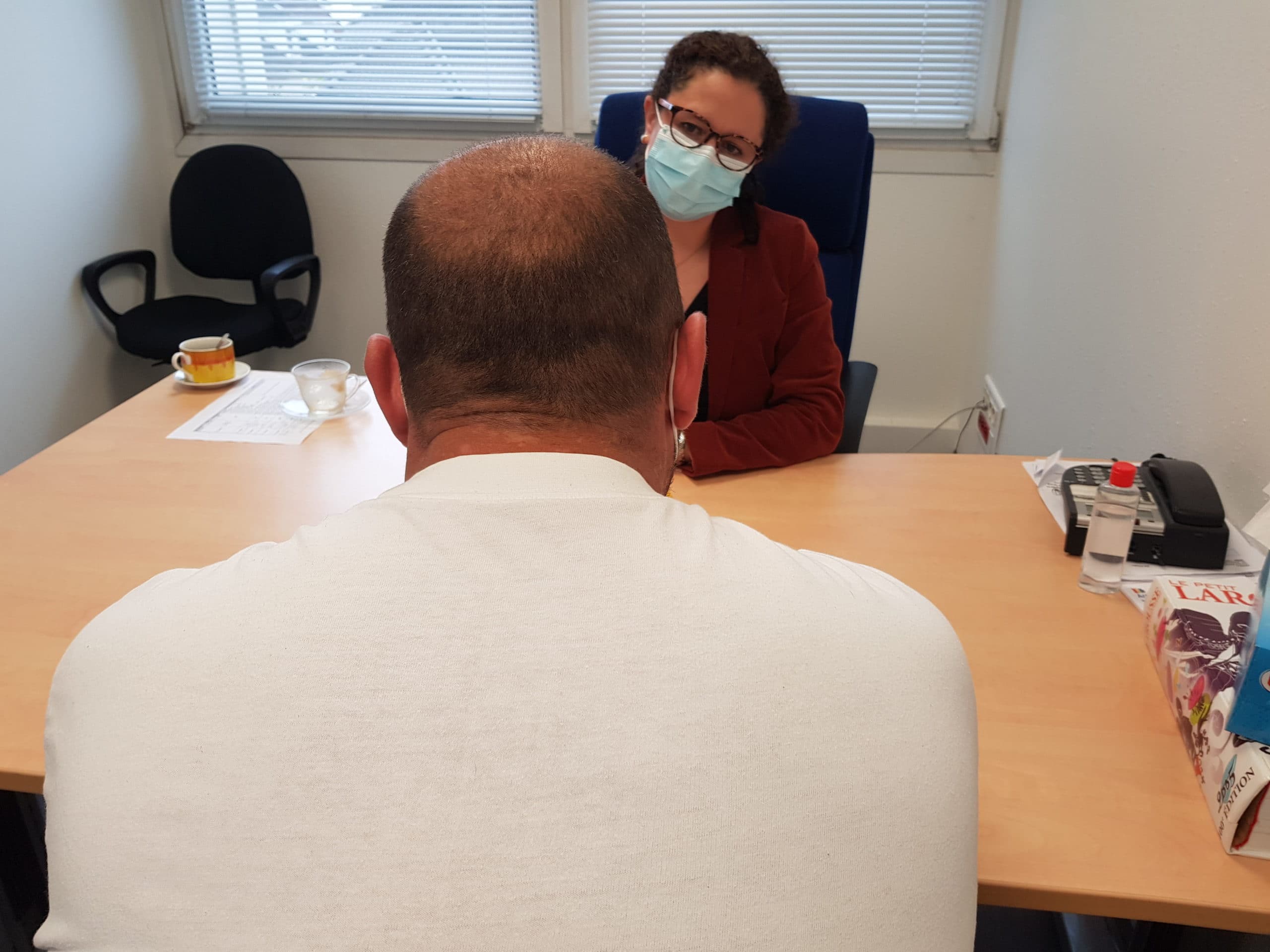


Chargement des commentaires…