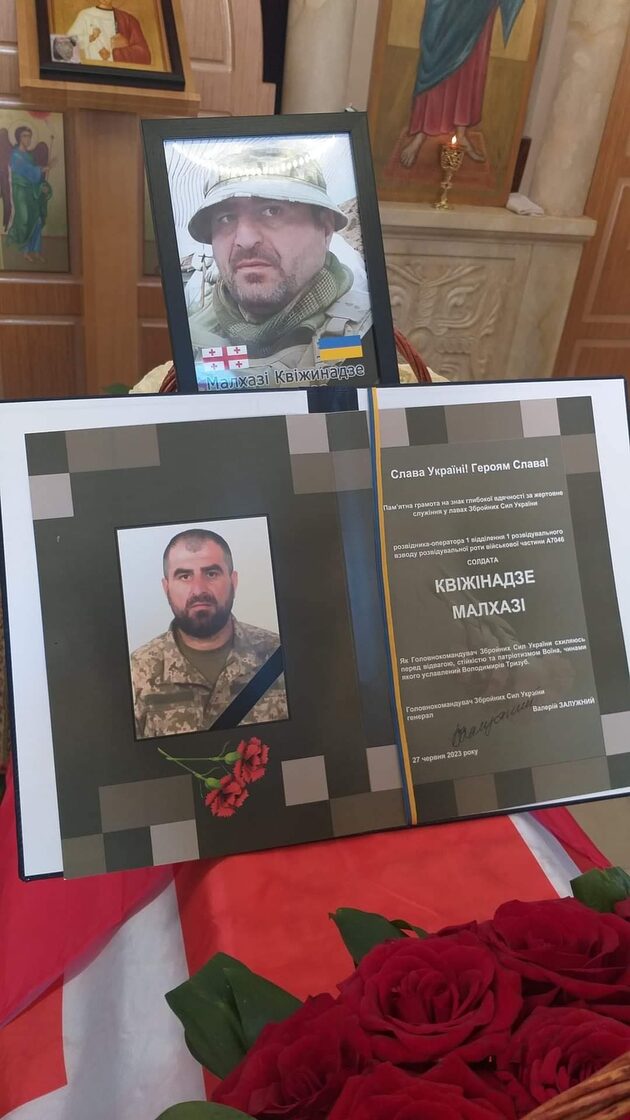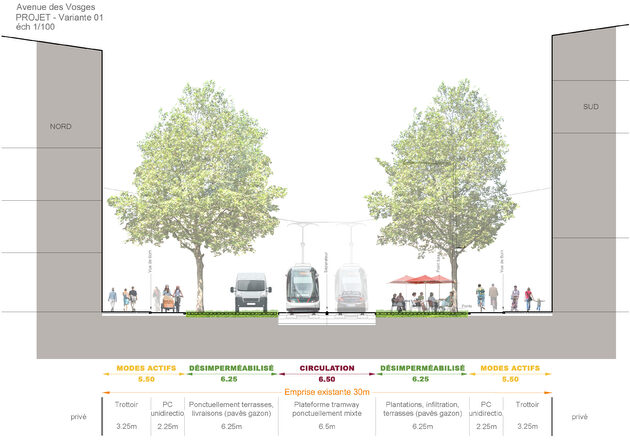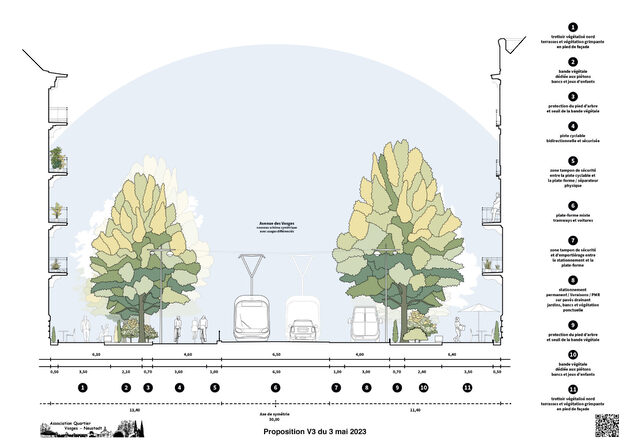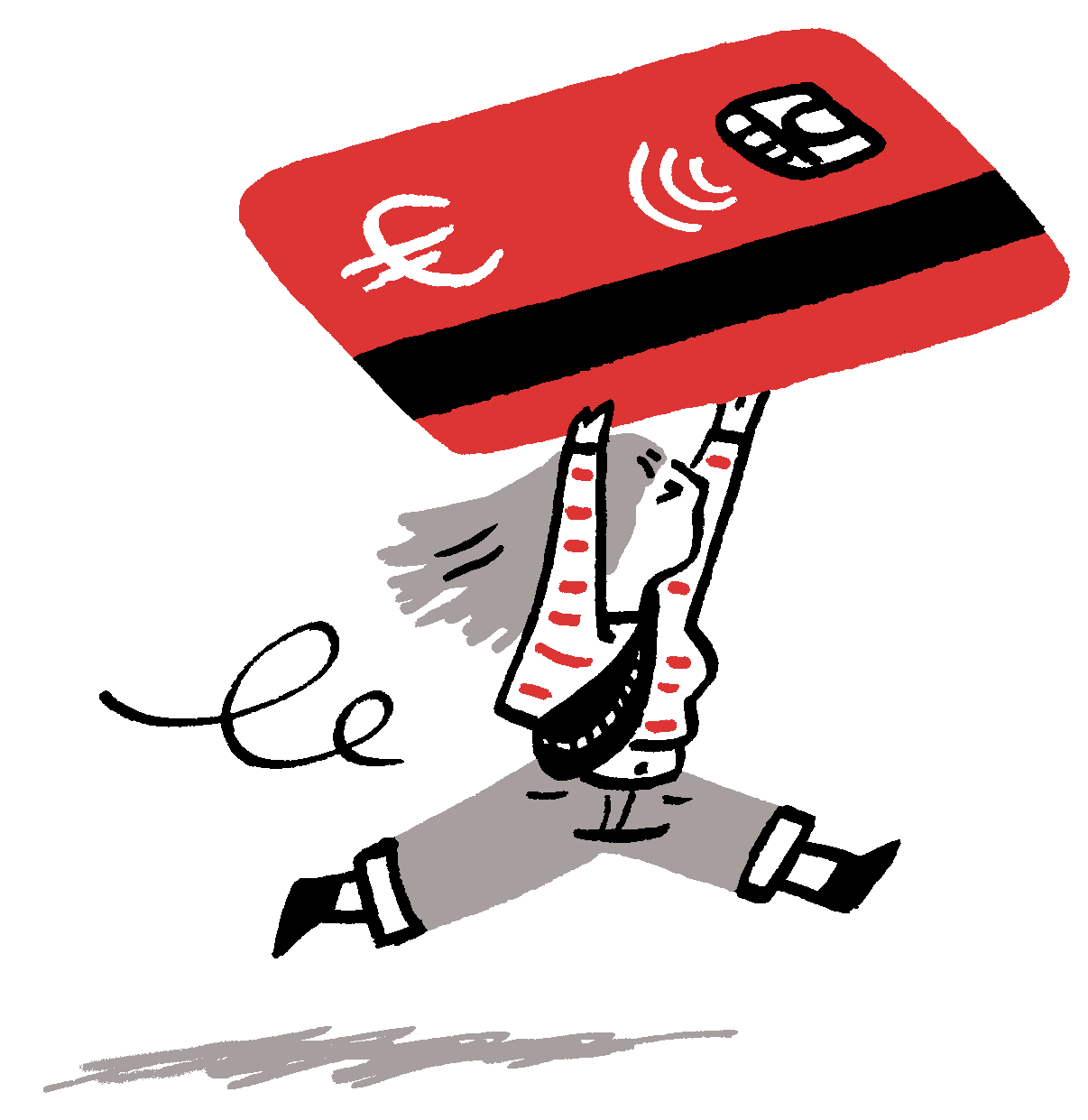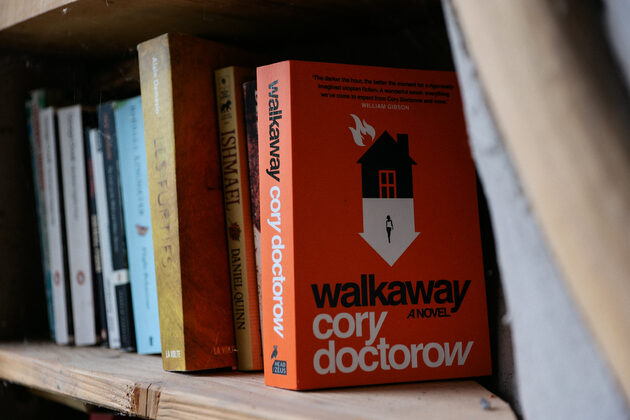Alors que le quartier de Cronenbourg s’est embrasé pendant plusieurs nuits suite à la mort du jeune Nahel à Nanterre, les éducateurs de rue, en première ligne face à la misère, reprennent leur travail en dépit des difficultés colossales.
Dans un petit appartement de la place de Haldenbourg, se trouve la cellule la plus en prise avec les jeunes de Cronenbourg : le Service de prévention spécialisée (SPS). Quatre à dix adultes, dont le métier est de sortir, un par un, les adolescents de la misère sociale. Après quatre nuits d’émeutes suite à la mort du jeune Nahel, tué par un policier lors d’un contrôle routier à Nanterre mardi 27 juin, ces éducateurs ont repris leurs missions, malgré le constat d’une dégradation continue de la situation sociale.
« Quand ça pète, ce n’est pas un échec »
Responsable du SPS, Norbert Krebs, 65 ans dont une trentaine passés dans le quartier de Cronenbourg, n’attend plus rien des politiques publiques :
« Je déteste tous les politiques, de droite comme de gauche. Je n’en peux plus des sociologues et des psychologues, qui prétendent connaître la banlieue et ses problèmes et qui nous bombardent avec leurs concepts fumeux. Ça fait 40 ans que la situation globale du quartier se dégrade, on sait très bien qu’à chaque étincelle n’importe où en France, même fantasmée, des émeutes peuvent éclater. »

Même discours de son collègue, Daniel Mallen, 57 ans, lequel cite volontiers les sociologues en revanche :
« Notre boulot, c’est de “prévenir la désaffiliation” comme ils disent. C’est à dire qu’on “prévient” tout : la pauvreté, le chômage, l’alcoolisme, les points de deal, les squats… C’est une mission politique de l’État, mais qui nous revient en cascade avec des moyens en baisse chaque année. De temps en temps, on arrive à sortir quelques jeunes… »
Le SPS accueille environ 300 jeunes par an dans son service, sur une population estimée à 2 000 jeunes de quinze à vingt ans (sur 20 000 habitants du quartier, dont 9 000 vivent dans la cité). Pour chaque jeune, il s’agit d’évaluer son lien avec la société et, pour les plus éloignés, de leur proposer un cadre de réinsertion, fait de rendez-vous de plus en plus réguliers dans des chantiers éducatifs rémunérés. Environ 150 jeunes ont bénéficié de ce type d’accompagnement en 2022.
Bien conscients de leurs limites, les deux éducateurs ne se démobilisent pas pour autant. Daniel reprend :
« Quand ça pète comme ça, je ne le vis pas comme un échec. Je l’intègre à la réalité du terrain sur lequel je travaille. On ne peut pas espérer que ça s’arrange avec des familles qui arrivent sans qu’on ne soit en mesure de les accueillir. Il faudrait beaucoup plus d’éducateurs et de services publics dans les quartiers, mais les gouvernements ont fait les choix inverses. »

Même s’il raille son collègue, qu’il appelle « Daniel de la Nupes », Norbert Krebs reprend en partie son discours :
« Il faut arrêter de victimiser ces populations. Les jeunes, c’est d’autorité dont ils ont besoin, de cadres. C’est de la maltraitance de les excuser en permanence. L’échec dans nos quartiers, c’est l’absence d’une culture commune, qui permet de vivre ensemble. »
Délégations en cascade
Initialement, la mission de prévention pour la jeunesse est une compétence de l’État, qu’il a déléguée aux Départements et que le Bas-Rhin a finalement déléguée à l’Eurométropole… À chaque fois, ces changements induisent de nouvelles manières de travailler et des budgets en baisse. En 2005, le Service de prévention a ainsi perdu deux postes d’éducateurs. Directeur de l’association du centre socio-culturel Victor Schoelcher, qui gère également le SPS, Laurent Cécile ne comprend pas cette politique de désertion :
« Il y a un mécanisme d’auto-entretien de la misère, avec des familles qui quittent le quartier dès qu’elles s’en sortent et d’autres, plus pauvres, qui arrivent. Avec nos moyens actuels, nous sommes incapables d’enrayer ce mécanisme et ses conséquences néfastes sur la population. Les millions d’euros de la rénovation urbaine ont bien ravalé les façades, et c’est positif, mais ce dont nous avons besoin, ce sont des adultes partout, pour contrer les effets délétères des logements en grandes tours… »
Laurent Cécile salue en contre-exemple la division par deux des classes de primaires à l’école Marguerite Perey et l’arrivée d’un concierge attitré à la cité, employé par le bailleur Somco.

Une police absente ou trop présente
L’épineuse question de la police et son rapport aux jeunes du quartier, exaspère Daniel Mullen. L’éducateur soupire :
« En tant qu’éducateurs, on connaît les commissaires en charge du quartier, mais avec les policiers de terrain c’est compliqué, même pour nous. Ils nous voient comme des complices. Contrôlés en permanence, avec souvent de la tension, des insultes voire des claques qui partent, les jeunes ont fini par voir la police comme une bande concurrente. Les relations n’ont cessé de se dégrader depuis la disparition de la police de proximité. »
Norbert Krebs, estime lui que « la police fait bien son travail ». « Je ne sais pas comment ils font pour travailler, alors qu’ils ne sont pas soutenus par le pouvoir. » Concernant la discrimination subie par les jeunes du quartier, il relativise à l’extrême : « Oui les jeunes sont discriminés, mais tout le monde l’est à un moment ! »
Sur la porte d’un bureau de la SPS, des citations de comptoir sont placardées : le « tout cramer pour repartir sur des bases saines » de Kaamelott côtoie une maxime plus classique sur l’accompagnement et l’autonomie. Les éducateurs repartent au contact des jeunes, jusqu’à la prochaine crise.